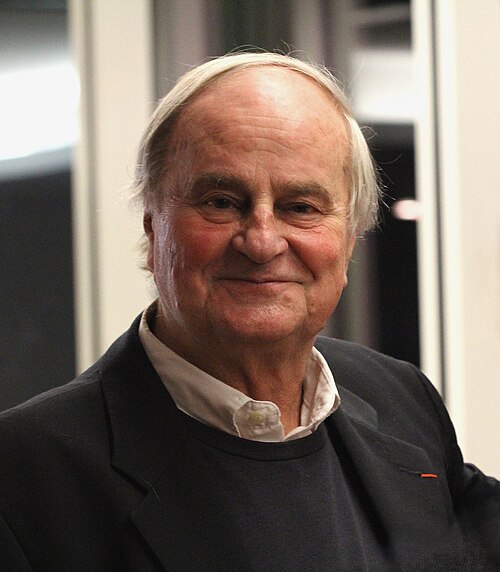
Ancien élève de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, Jacques Livage soutint son doctorat d’État à l’Université Paris-Sorbonne en 1966 avant d’être nommé professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) en 1974. Il fut ensuite titulaire, de 2001 à 2009, de la chaire Chimie de la matière condensée au Collège de France, et élu membre de l’Académie des Sciences en 2001.
Tout au long de sa carrière, Jacques Livage a exercé un rôle déterminant dans l’organisation de la recherche française, tant au CNRS qu’à l’UPMC (devenue Sorbonne Université). Il a occupé plusieurs fonctions structurantes à l’UPMC : président du conseil scientifique de l’UER de chimie inorganique de l’UPMC (1984-1988), directeur de la formation d’ingénieurs “Chimie des matériaux” (1987-1996) et président du groupe d’experts “Chimie physique et matériaux” à la direction des recherches et études doctorales (1990-1991). Il fut chargé de mission auprès de la direction scientifique de la chimie du CNRS (1973-1976), président du comité d’Action Thématique Programmée “Chimie Fine” du CNRS (1980-1984) et responsable du groupement de recherches “Sol-Gel Inorganique” (1988-1994). Il a également été président de la division “Chimie du Solide” de la Société française de chimie (1995-1998) et consultant “Matériaux” à la direction des recherches du ministère de l’Éducation nationale (1982-1986).
Jacques a profondément marqué l’histoire de notre laboratoire qu’il a fondé fin des années 70, initialement sous le nom de Laboratoire de Spectrochimie du solide, devenu en 1988, Chimie de la Matière Condensée, et qu’il a fait rayonner au plus haut niveau international. Reconnu comme l’initiateur de la chimie sol-gel en France, en parallèle des travaux de C. Jeffrey Brinker et George W. Scherer aux États-Unis, Jacques Livage a contribué à structurer la communauté internationale de la chimie des matériaux. Il a posé les bases d’un champ devenu aujourd’hui central. Scientifique de renommée mondiale, il est considéré comme l’un des fondateurs de la chimie douce, approche novatrice de la synthèse des matériaux à basse température qu’il décrivait dans un premier article du Monde en octobre 1977. Ses travaux dans ce domaine ont permis la création de verres, céramiques et matériaux composites à partir de précurseurs en solution, évitant ainsi les traitements à très haute température propres aux voies classiques. En 1978, il fonde avec Jean Rouxel, l’École d’été Galerne consacrée à la chimie douce qui a permis de structurer la communauté française. Il co-édita la première édition du Journal of Sol-Gel Science and Technology en 1993, aux côtés de Sumio Sakka (Kyoto University, éditeur en chef) et de Kanichi Kamiya (Mie University, co-éditeur).
Par ailleurs, Jacques Livage a développé une recherche pionnière à la croisée de la chimie des matériaux et de la biologie. Il s’est notamment intéressé aux processus de biominéralisation, observant comment certains micro-organismes, tels que les diatomées ou les algues, élaborent des nano-structures complexes de silice ou d’oxydes métalliques. Cette approche l’a conduit à imaginer et à réaliser, grâce aux procédés sol-gel, des matrices minérales au sein desquelles il a pu immobiliser des espèces biologiques (enzymes, anticorps, bactéries, virus, micro-algues…). Les espèces immobilisées conservent leur activité biologique permettant de réaliser des biocapteurs et des bioréacteurs. Par ces travaux, il a ouvert la voie à de nombreuses applications dans le domaine des biocapteurs, des bioréacteurs et des matériaux biofonctionnels (leçon inaugurale au Collège de France le 17 janvier 2002).
Jacques Livage laisse un héritage scientifique durable et profond dans la chimie moderne des matériaux qui a su allier rigueur et imagination tout au long de sa carrière, inspirant des générations d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants à Sorbonne Université et bien au-delà.
Au-delà du scientifique et du professeur, Jacques était pour beaucoup un collègue et un ami, toujours disponible, attentif et d’une grande humanité. Sa gentillesse, son humour et sa passion communicative pour la recherche nous manqueront profondément. Nous garderons en mémoire les bons moments partagés, les discussions inspirantes et l’impact qu’il a eu sur nos vies et sur notre manière de concevoir la science.
Le Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris et Sorbonne Université adressent leurs pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés.
La communauté scientifique perd aujourd’hui une figure majeure : non seulement un chercheur d’exception, mais aussi un bâtisseur de ponts entre chimie, biologie et science des matériaux. Sa mémoire et son œuvre continueront d’inspirer les générations futures.
Les directions passées et présentes du LCMCP
Clément Sanchez, Florence Babonneau, Christian Bonhomme et Corinne Chanéac
